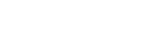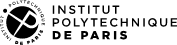Quand les bactéries font de la résistance

« Les antibiotiques, c’est pas automatique ». Tout le monde se souvient de ce slogan de l’Assurance-maladie, largement diffusé en 2002. Derrière cette formulation habile transparait un problème de santé publique majeur, l’antibiorésistance. Si depuis 20 ans des agences internationales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sensibilisent et incitent les gouvernements à agir, les effets se font encore peu sentir. L’OCDE et l’agence santé publique France estiment par exemple qu’en l’état actuel, près de 240 000 personnes pourraient mourir d’ici 2050 (1) dans l’Hexagone des suites de l’adaptation des bactéries pathogènes aux antibiotiques.
Objet frontière
En novembre 2023, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) a lancé son premier séminaire dédié à l’antibiorésistance et, plus largement, à l’antimicrobiorésistance (AMR – survient quand une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite ne répond plus aux médicaments). Porté par son centre interdisciplinaire pour l’ingénierie de la santé E4H (Engeeniring for Health), il a pour mot d’ordre l’interdisciplinarité et met en œuvre une nouvelle dynamique de recherche et de collaboration. En effet, les défis sont multiples : scientifiques, afin de comprendre les mécanismes fondamentaux des résistances, pharmacologiques pour développer de nouvelles molécules, mais aussi économiques et de politique publique.
« Du point de vue des sciences sociales, l’AMR est un objet frontière. C’est-à-dire un sujet d’étude qui ne peut se limiter à une seule science ou un seul groupe de chercheurs », explique Jocelyne Arquembourg, professeure émérite en sciences de l’information et de la communication au sein du département de sciences sociales et management de IP Paris. « Il y a ici des compétences en chimie, en biologie, en mathématiques, en intelligence artificielle et en physique qui n’étaient pas mobilisées jusqu’à lors autour de l’AMR. La démarche que nous initions mutualisera les potentiels et croisera les approches. C’est très motivant ». Les sciences de l’information et de la communication complètent cette force de frappe par la vision historique qu’elles apportent sur l’émergence de l’AMR et l’évolution du regard de la société sur les antibiotiques. Elles ouvrent de nouvelles perspectives sur la façon d’appréhender le problème.
Molécules miracle ou polluants ?
Coup d’œil dans le rétroviseur. À la sortie de la deuxième guerre mondiale et pendant plusieurs décennies, les antibiotiques sont perçus comme des produits miracles tant ils contribuent à la guérison de certaines maladies mortelles (la tuberculose par exemple) ou sexuellement transmissibles et facilitent la chirurgie. Ils abondent même à leurs débuts dans les pommades, les collyres et sont utilisés pour la conservation des aliments. Parallèlement, leur rôle de promoteurs de croissance dans l’élevage est prouvé. Ils sont alors mêlés à l’alimentation des animaux, sans geste vétérinaire, et dépassent largement la sphère de la santé humaine.
La dissémination de ces molécules fait pression sur les bactéries qui développent des stratégies pour leur survivre. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’une antibiorésistance s’installe. Alexander Fleming, le père de la pénicilline, reconnaissait lui-même le phénomène dans les colonnes du journal le Monde en 1953. « Fort d’un recul d’une dizaine d’année sur l’utilisation des antibiotiques, il ne constatait aucune incidence néfaste sur la santé humaine et laissait entendre qu’il suffisait de devancer la stratégie des bactéries pour gérer l’antibiorésistance ; une doctrine suivie par les scientifiques jusque dans les années 1990 avec le développement régulier de nouvelles générations d’antibiotiques », souligne Jocelyne Arquembourg.
Lorsque certains brevets tombent dans le domaine public, les grands groupes pharmaceutiques se détournent du développement de nouvelles molécules, faute de rentabilité. L’innovation revient alors aux start-ups mais leur puissance est bien plus limitée. Dans le même temps, des associations de consommateurs scandinaves perçoivent le danger sanitaire que représente l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage. Elles militent pour leur abandon et sont entendues par l’Union Européenne qui les interdit en tant que promoteur de croissance en 2006 (Les États-Unis suivront 10 ans plus tard). « La société a fait évoluer l’usage et le cadre réglementaire autour des antibiotiques. Aujourd’hui, la présence de certains d’entre eux est même surveillée et quantifiée dans les eaux et les sols ». C’est par exemple le cas du sulfaméthoxazole, intégré en 2020 à la directive cadre européenne sur l’eau, puis en avril 2022 à la liste française des polluants spécifiques de l’état écologique (2). « Nous sommes loin de l’antibiotique miracle du lendemain de la guerre », ironise la professeure émérite. À noter qu’aux molécules que l’être humain et les animaux sous antibiothérapie excrètent dans l’environnement, s’ajoute la dispersion du matériel génétique des bactéries ayant acquis une résistance dans le tube digestif de ces derniers.
Santé unique
La santé des écosystèmes entre donc à présent largement dans le scope de l’antibiorésistance, aux côtés de la santé humaine et de la santé animale. De fait, depuis 2015, l’OMS incite les gouvernements à prendre le problème à bras le corps sous une approche holistique (One Health) en considérant ces trois domaines. Si une dynamique internationale a été lancée via certains États (Allemagne et Grande-Bretagne notamment), il est impossible de ne pas tenir compte des spécificités régionales dans la mise en œuvre de mesures efficaces. « En France par exemple, une feuille de route interministérielle a été publiée en 2016. Les actions de prévention et de surveillance se multiplient (Programme prioritaire de recherche antibiorésistance, réseau Promise, plans Ecoantibio…) mais la question de la surveillance des eaux ne pourra pas se faire sans l’engagement des élus locaux ».
Le projet de l’Institut Polytechnique de Paris est donc de rassembler le regard innovant de chercheurs aux côtés d’acteurs des milieux économique et associatif mais aussi des spécialistes de la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, à l’instar du réchauffement climatique, l’antibiorésistance, et plus largement l’antimicrobiorésistance, soulève des enjeux complexes : qui peut agir ? comment ? qui subit ? « Cela nous oblige à recalibrer nos pratiques de recherche et leur mise en œuvre, en privilégiant par exemple les aller-retours entre laboratoire et société civile et ainsi à répondre efficacement aux attentes sociétales. Notre action doit nourrir le dialogue qui à terme comblera le fossé entre scientifiques qui alertent d’un côté et acteurs publics qui tâtonnent de l’autre, faute d’éléments factuels pour orienter leurs politiques publiques », conclut Jocelyne Arquembourg.
À propos :
Jocelyne Arquembourg est chercheuse associée à Télécom Paris et professeure en sciences de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle travaille sur la médiatisation et la communication de problèmes de santé publics, en particulier sur l’antibiorésistance. Elle a publié de nombreux articles sur le sujet, elle a fait partie du comité scientifique du JPIAMR, du rapport du Dr. Carlet, et du Programme Prioritaire de Recherche sur l’antibiorésistance.