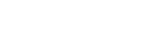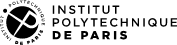Troubles cognitifs : le diagnostic par les ondes

Plus qu’un outil de recherche, l’électroencéphalogramme (EEG) combiné à l’intelligence artificielle pourrait devenir un moyen simple de détection des troubles neurocognitifs, aussi appelés démences vasculaires. Au cours de sa thèse, Maxime Bedoin a utilisé l’EEG pour différencier ces troubles (provoqués par de petits infarctus dans le réseau vasculaire cérébral) de la maladie d’Alzheimer.
Le jeune docteur s’est attelé à l’analyse des ondes cérébrales de patients touchés par ces affections. « On sait que leur fréquence dans la bande alpha ralentit chez les malades d’Alzheimer, mais nous souhaitions aller au-delà de cette analyse fréquentielle et exploiter d’autres paramètres à partir de ces signaux », explique-t-il. Sa thèse a donc porté sur l’étude de la connectivité des ondes cérébrales, à savoir leur synchronisation temporelle et en amplitude. « Quand deux signaux d’EEG sont synchronisés, il y a une forte probabilité pour qu’ils aient une causalité commune ou que les zones cérébrales dont ils émanent communiquent entre elles ».
Faire émerger des profils avec l’IA
Une base de données issue de 90 patients des hôpitaux de Lille et Charles Foix à Vitry-sur-Seine (94) a été utilisée pour mener à bien ces travaux. Le chercheur a délimité huit régions sur le cortex des malades qu’il a équipées d’électrodes. En relevant les valeurs enregistrées par des paires d’électrodes au sein de ces zones, il a établi des matrices de connectivités inter-régions et intra-régions. « Nous avons soumis ces données à un algorithme d’apprentissage supervisé (c’est-à-dire s’appuyant sur les informations associées aux données : Alzheimer, troubles neurocognitifs, etc.). Il est apparu que chez les patients atteints de troubles neurocognitifs, la connectivité intra-région était inférieure à celle enregistrée chez les malades d’Alzheimer et chez les personnes présentant des plaintes subjectives de mémoire », indique le chercheur.
Cette première approche n’est toutefois pas sans limites. En effet, les informations liées aux données d’EEG sont potentiellement incomplètes puisqu’une fois le diagnostic posé, les autres causes potentielles de dysfonctionnement ne sont pas recherchées. Maxime Bedoin s’est alors concentré sur les données brutes et non sur leur labélisation. « Nous avons eu l’intuition qu’en utilisant un algorithme d’apprentissage non supervisé, la visualisation de l’ensemble des données aboutirait à un résultat intéressant. Par une méthode d’agrégation (le clustering), l’algorithme a fait émerger 7 tendances de connectivités en fonction des maladies, donc 7 profils de patients ».
Ces résultats sont cohérents avec ceux observés lors de la première phase de l’étude : les malades d’Alzheimer présentent une connectivité moyenne à forte, et les patients vasculaires de faibles connectivités. Le clustering a par ailleurs révélé que les premiers montraient une connectivité dense dans la zone occipitale et les seconds dans la zone frontale. Les patients témoins concentrent quant à eux la connectivité dans cette même zone. En d’autres termes, avoir une diminution de la connectivité moyenne est un indicateur de troubles neurocognitifs, tandis qu’un décalage de la connectivité vers la région occipitale est caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Ce que les tests menés sur des patients mixtes ont confirmé en présentant des caractéristiques de chacune des maladies.
Médecine de précision
« C’est un des avantages de notre méthode : visualiser le patient typique d’un cluster et en déduire des variables déterminantes pour ce dernier (ici la répartition de la connectivité). De fait, lorsqu’un malade passe un EEG, il est possible d’établir un diagnostic s’il présente des variables représentatives d’un profil. On tend ici vers de la médecine de précision », se réjouit Maxime Bedoin.
Avec le clustering, les médecins disposent en effet d’arguments cliniques qu’ils peuvent confronter à leur propre expérience, là où un algorithme classique n’afficherait qu’une probabilité de risque. Bien plus facile à paramétrer qu’une intelligence artificielle utilisant un réseau de neurones, non invasive, plus souple et disponible qu’une IRM, la méthode mise au point au cours de la thèse de Maxime Bedoin est un réel outil d’aide à la décision pour les cliniciens.
NB : cette publication s'inscrit dans le cadre du projet DaTSHealth (ANR-CMAS-0033)

Maxime Bedoin est ingénieur diplômé de Télécom SudParis. Il a travaillé entre février 2021 et septembre 2022 en tant qu'ingénieur de recherche dans l'équipe Armédia du laboratoire SAMOVAR, puis en tant que doctorant dans la même équipe à partir d'octobre 2022. Il a obtenu son diplôme de docteur en octobre 2025.
*SAMOVAR : un laboratoire de recherche Télécom SudParis, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France