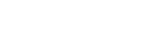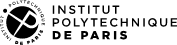Mécanique et chirurgie maxillo-faciale, le duo gagnant

Dans le film Bienvenue à Gattaca, le personnage qu’interprète Ethan Hawke évolue dans une société eugéniste et cherche à réaliser son rêve de devenir astronaute, quitte à modifier ses caractéristiques physiques. En l’occurrence, à rallonger ses fémurs à l’aide de distracteurs. Si la situation relève de la dystopie, les appareillages visant à allonger les os existent bel et bien, notamment pour les mandibules. Dans ce dernier cas, le dispositif est constitué de deux plaques apposées de part et d’autre d’une mâchoire inférieure que l’on a coupée. Elles sont alors reliées par une vis sans fin, dont la rotation permet d’écarter progressivement les deux morceaux d’os.
« La vis est actionnée quotidiennement à l’aide d’une tige transcutanée pour allonger l’os d’1mm par jour environ. La plupart du temps, ce sont les parents qui réalisent le geste, avec toutes les appréhensions et les douleurs que cela peut engendrer chez leur enfant comme chez eux », explique Jean Boisson. Spécialiste en mécanique de structures aimantées, le chercheur du LMI se rapproche de Natacha Kadlub, professeur à l’hôpital Necker, praticienne en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie plastique pédiatrique, pour développer un distracteur mandibulaire débarrassé de cette tige de torture.
Maitriser le processus d’allongement
Jean Boisson consacre alors ses travaux au champ magnétique, aux interactions entre aimants et à leur conception, et Natacha Kadlub à l’adaptabilité du dispositif au milieu chirurgical. Leur distracteur est composé d’aimants néodyme-fer-bore permanents internes et externes, magnétisés diamétralement (ndlr : des aimants cylindriques ou en forme de disque par exemple, sont aimantés sur leur diamètre, les pôles magnétiques sont donc situés sur la surface courbe des aimants et non sur leur face plate) et activés par un moteur instrumenté. L’activateur, qui contient l’aimant externe, exerce un couple sur l’aimant interne. Si le couple mécanique transmis entre les deux aimants est suffisant, il est possible d’étirer les tissus mous et de réaliser la distraction « à distance », sans tige transcutanée, tout en s’assurant, grâce aux capteurs implantés dans l’activateur, d’appliquer le bon nombre de tours au bon moment.
Pour parvenir à ce résultat, le chercheur a modélisé les deux aimants impliqués. « Il existe des modèles physiques qui déterminent l’énergie magnétique d’interaction entre deux aimants permanents comme les nôtres. On s’aperçoit qu’au-delà de la puissance et de la distance entre eux, la géométrie des aimants influence le couple transmis ». En confrontant son modèle à ses expérimentations, le chercheur a pu déterminer le couple et la taille des aimants nécessaires au nouveau dispositif. « Un dernier enjeu a consisté à les rendre biocompatibles sans en dénaturer les propriétés physiques ». Challenge relevé grâce à l’expertise d’une entreprise du sud de la France, capable d’encapsuler par projection de plasma de titane à froid les aimants de Jean Boisson.
Depuis 2017, les deux scientifiques sont accompagnés vers un processus de transfert technologique par la Satt Paris-Saclay (Société d'accélération et de transfert technologique) via un contrat de licence avec l'ENSTA. Leur dispositif est désormais prêt à entrer dans cette phase et une entreprise l’adaptera à ses chaines de production en vue d’une mise sur le marché dans les 5 années à venir. Ce projet a par ailleurs permis aux deux chercheurs de recevoir le prix de la Fondation des Gueules Cassées 2024 (elle aussi financeuse du projet).
Enrichir les connaissances scientifiques
En attendant, les travaux de Jean Boisson et Natacha Kadlub ont ouvert la voie à des pistes de recherche plus fondamentales. L’Agence de l’innovation de défense (AID), rattachée au Délégué général pour l'armement (DGA), ainsi que le Centre interdisciplinaire Engineering for Health (E4H), apportent depuis plusieurs années leur soutien à ces travaux de recherche. Pour développer leur dispositif, les scientifiques se sont en effet intéressés à la mécanique du périoste, ce tissu qui recouvre tous les os du corps, donc celui de la mandibule, et sur lequel le distracteur est implanté. « Il nous a fallu évaluer les forces appliquées sur la tige par les tissus mous situés autour de la fracture infligée à la mandibule. Nous avons donc déterminé des lois de comportement du périoste et démontré que c’est bien ce dernier qui oppose le plus de résistance à la distraction », précise le chercheur. La littérature scientifique souligne par ailleurs que le périoste, également impliqué dans le remodelage osseux, pourrait accélérer la cicatrisation en fonction de son état mécanique. Son adhésion à l’os n’est pas non plus suffisamment documentée et une thèse est en cours pour la caractériser et en comprendre le rôle.
Une autre thèse est également lancée sur l’impact du champ magnétique des aimants néodyme-fer-bore sur les cellules et le remodelage osseux. Elle entre dans le cadre du projet collaboratif MAGBONE, soutenu par l'AID et le Centre interdisciplinaire d’études pour la défense et la sécurité (CIEDS). « Des études évoquent une meilleure différenciation des cellules et des densités osseuses plus importantes. Nous allons donc approfondir la question, en lien avec l’hôpital Lariboisière, et voir si les propriétés mécaniques du périoste et de l’os créé sous champ magnétique diffèrent des tissus natifs », conclut Jean Boisson.

À propos
Jean Boisson est enseignant-chercheur au Laboratoire de Mécanique et ses Interfaces de l’ENSTA. Il étudie notamment l’action mécanique de structures magnétiques et la biomécanique. Ses travaux de recherche le mènent à isoler et comprendre l’influence qu’exerce le champ magnétique sur les propriétés mécaniques de systèmes complexes.
Jean Boisson a obtenu un doctorat de chimie physique théorique de l'École Normale Supérieure de Paris (ENS) en 2008. Après différentes missions de post-doctorat au CEA, à l’université Paris-Saclay et à l’ENS, il rejoint l’ENSTA en tant qu’enseignant-chercheur en 2012 et y intègre l’Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles (IMSIA).
>> La page personnelle de Jean Boisson sur le site de l'ENSTA
>> Jean Boisson sur Google Scholar
*LMI : une unité propre, ENSTA, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France