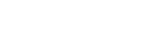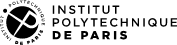Maladies neurologiques : quand l’IA mesure les écarts de marche
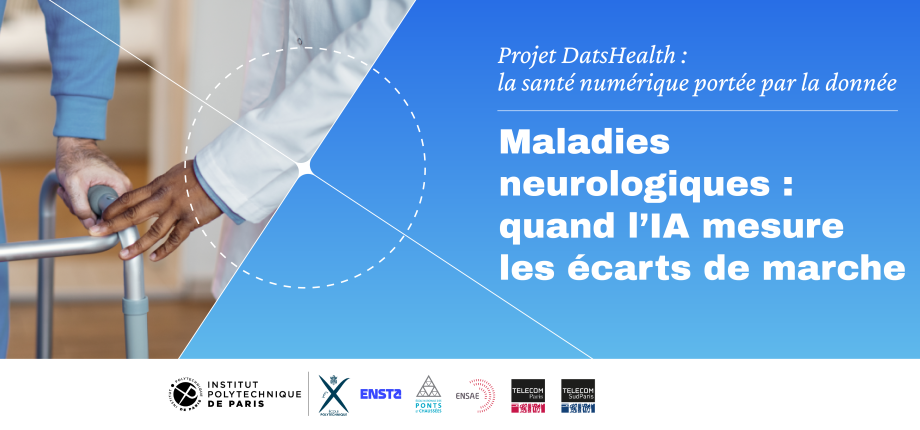
Et si l’intelligence artificielle contribuait à la réhabilitation de la marche chez les patients victimes de maladies neurologiques (AVC, maladie de Parkinson, sclérose en plaques...) ou d’un traumatisme impactant leurs capacités motrices ? Au cours de sa thèse au laboratoire SAMOVAR, Lorenzo Hermez s’est intéressé à la façon dont les méthodes d’apprentissage automatique pourraient innover et éclairer les praticiens dans leurs choix thérapeutiques.
Le jeune docteur s’est notamment concentré sur les injections de toxine botulique qui réduit les spasmes musculaires et retonifie la marche. « Cette technique est encore assez expérimentale. Le clinicien ne dispose que de son expérience pour déterminer les doses nécessaires et les zones à cibler. Le machine learning devient alors un véritable outil d’aide à la décision », indique Lorenzo Hermez. Le constat est le même avec certains traitements médicamenteux de la maladie de Parkinson dont les effets ont également été étudiés au cours de cette thèse.
La marche, un processus pas si simple
Pour en arriver là, il a tout d’abord fallu qualifier et quantifier la marche d’un point de vue mathématique et numérique, en commençant par la marche normale. Cette dernière résulte d’un processus complexe qui s’acquiert tout au long de la vie et présente une importante variabilité qu’il fallait également définir. Or, jusqu’à présent, la littérature ne considérait pas ce paramètre. Les données étaient normalisées et ne décrivaient qu’un type de marche normale.
Lorenzo Hermez a donc étudié des cycles de marche de différentes longueurs : ceux des étudiants, personnels et praticiens du centre de réadaptation de Coubert (77) - établissement partenaire du SAMOVAR pour sa thèse. À l’aide de caméras et de capteurs braqués sur leurs membres inférieurs, il a recueilli de nombreux signaux sur les cinématiques angulaires de leurs chevilles, genoux, hanches, etc. « Grâce à des outils mathématiques, nous avons analysé ces cycles en nous basant sur des données issues de points de mesure communs aux articulations de ces personnes. Leur traitement à l’aide du machine learning et d’un algorithme spécifique nous a permis de dégager trois grands groupes de données, soit autant de profils de marche normale », explique Lorenzo Hermez.
Quantifier la marche pathologique
En appliquant cette technique à des patients atteints de para ou tétraparésie (ndlr : un déficit incomplet de la force musculaire de deux ou quatre membres), il devient alors possible d’interpréter les signaux liés à leur marche au regard du modèle de références établi. Les chercheurs en déduisent un score qui quantifie la distance séparant ces signaux des trois profils normaux. « Nous nous sommes par ailleurs aperçus qu’en cas d’hémiparésie (la faiblesse musculaire sur un côté du corps) ces scores donnaient de précieux indices sur le membre impacté et sa dégradation pathologique », ajoute le chercheur.
Dans un deuxième temps, Lorenzo Hermez a transformé ces signaux en images contenant davantage d’informations. « Nous avons construit des cartes de dissimilarités qui renseignent sur la distance entre deux signaux à la fois dans le temps et dans l’espace. Elles offrent un regard plus complet et précis sur la marche, notamment sur la façon dont celle-ci évolue d’un côté par rapport à l’autre (une visualisation bilatérale). Ce que ne permet pas le traitement des données brutes. D’une manière générale, les images sont plus intéressantes car plus facilement interprétables pour un cerveau humain, mais aussi informatiquement ». Ainsi, à l’aide d’autres outils mathématiques, les cartes de dissimilarités ont, elles aussi, été utilisées pour établir un modèle global de marche normale puis déterminer et quantifier des déviations caractéristiques de marches pathologiques.
Au cours de sa thèse, Lorenzo Hermez a par ailleurs démontré que cette méthode était applicable à d’autres bases de données. « Nous avons pu quantifier les risques de chute chez les patients se remettant d’un AVC. Nous nous sommes également intéressés aux signaux de personnes souffrant de la maladie de Parkinson et avons mesuré le gel de la marche à l’aide des cartes de dissimilarités ».
Si aujourd’hui les travaux de Lorenzo Hermez n’offrent pas encore d’accompagnement clinique, ils sont en mesure d’aider les praticiens à acquérir de l’expérience. Ces derniers sont alors disposés à mieux poser les diagnostics mais aussi mieux évaluer et adapter les traitements. Le tout plus rapidement.
NB : cette publication s'inscrit dans le cadre du projet DaTSHealth (ANR-CMAS-0033)

Lorenzo Hermez est docteur en analyse de données et intelligence artificielle pour l’humain, diplômé de Télécom SudParis (Institut Polytechnique de Paris). Ses travaux portent sur le développement de méthodes d’apprentissage automatique pour la caractérisation du mouvement humain et l’évaluation des troubles moteurs d’origine neurologique. Passionné par la recherche à l’interface entre IA, santé et biomécanique, il collabore étroitement avec le milieu clinique pour concevoir des outils interprétables et utiles au diagnostic. Il poursuit actuellement ses recherches au sein de l’INRIA Lille sur l’analyse de données cliniques pour la médecine personnalisée.
>> Lorenzo Hermez sur Google Scholar
>> Lorenzo Hermez sur le site du SAMOVAR
*SAMOVAR : un laboratoire de recherche Télécom SudParis, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France